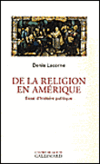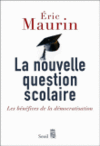Jean Bazin, mort en 2001, n’avait jamais publié de livre de son vivant. Il estimait, modeste et insatisfait, que ses textes devaient être retravaillés. Grâce au travail éditorial d’Alban Bensa, lequel est aussi la manifestation d’une vieille amitié, on peut avoir accès à une œuvre originale et fort dérangeante, parce qu’elle entend débarrasser l’anthropologie de ses routines et de ses illusions, qu’elle a d’ailleurs souvent contractées dans la période coloniale (Jean Bazin, Des clous dans la Joconde. L’anthropologie autrement, Toulouse, Anacharsis, 2008, 608 p., 28 €). Faire de l’anthropologie autrement, ce n’est pas nécessairement faire de l’anthropologie négative : si ses collègues redoutaient quelquefois cet empêcheur de penser en rond pour sa rigueur et sa franchise, ils n’en connaissaient pas moins la fécondité de ses analyses. L’ouvrage contient dix-sept contributions dont une seule, le « Chalet basque », est inédite. Les autres textes ont suscité de vifs débats dans la communauté anthropologique et au-delà car ils forçaient tous à penser de manière critique les pratiques ordinaires des sciences de l’homme. Comme beaucoup d’autres, Jean Bazin avait commencé par être philosophe avant de faire du terrain en Afrique. Mais, à la différence de beaucoup de ses collègues, il l’était resté, comme le fait remarquer Vincent Descombes, co-préfacier de l’ouvrage. Il n’avait pourtant jamais renoncé au travail empirique, comme l’explique en toute connaissance de cause l’autre préfacier, Alban Bensa. Dans une série de textes denses mais toujours aisés à lire, Jean Bazin, nourri simultanément de la pensée de Marx et de celle de Wittgenstein, un alliage rare mais fécond ici, montre que la « culture » n’est pas un fait d’observation, ni une donnée d’expérience (ce que l’ethnographe rapporterait du terrain), mais c’est le produit d’une opération dont il convient de faire l’analyse critique. Contrairement au discours aujourd’hui dominant de la diversité culturelle, Bazin pense que le travail de l’anthropologie n’est pas de promouvoir l’altérité, mais de la réduire. C’est l’occasion pour lui de faire une très belle analyse de la notion d’authenticité et une déconstruction de la notion d’ethnie, dont le très beau texte « A chacun son bambara », témoigne magistralement. Il écrit ainsi : « Qu’on croit ou non à sa réalité substantielle, l’ethnie est ce sujet fictif que l’ethnologie contribue à faire être, le perpétuant comme entité de référence dans son espace savant, grâce à ses procédures inductives et attributives par lesquelles un contenu de savoir, si disparate soit-il, se trouve réuni et subsumé sous un seul nom, dans le même compartiment d’un fichier » (p. 107). Dans ses textes sur la description ou sur la production du sens dans l’opération ethnographique, il contribue d’une manière inédite à l’épistémologie des sciences sociales. À la différence de Dan Sperber, dans le Savoir des anthropologues, Jean Bazin ne renonce pas à l’anthropologie pour aller sur d’autres terrains : il recommande simplement une anthropologie armée par la philosophie et nourrie d’une réflexion politique, particulièrement sensible dans ses remarquables travaux d’anthropologie historique sur le royaume de Segou, où il montre l’existence d’un champ politique inchoatif, mais déjà présent. La reconnaissance d’une dimension proto-politique de la vie collective permet de ne pas tomber dans l’illusion des sociétés sans Etat comme sociétés libérées de l’instance politique. La critique serrée de l’œuvre de Pierre Clastres constitue l’un des moments forts du volume.
Jean Bazin, mort en 2001, n’avait jamais publié de livre de son vivant. Il estimait, modeste et insatisfait, que ses textes devaient être retravaillés. Grâce au travail éditorial d’Alban Bensa, lequel est aussi la manifestation d’une vieille amitié, on peut avoir accès à une œuvre originale et fort dérangeante, parce qu’elle entend débarrasser l’anthropologie de ses routines et de ses illusions, qu’elle a d’ailleurs souvent contractées dans la période coloniale (Jean Bazin, Des clous dans la Joconde. L’anthropologie autrement, Toulouse, Anacharsis, 2008, 608 p., 28 €). Faire de l’anthropologie autrement, ce n’est pas nécessairement faire de l’anthropologie négative : si ses collègues redoutaient quelquefois cet empêcheur de penser en rond pour sa rigueur et sa franchise, ils n’en connaissaient pas moins la fécondité de ses analyses. L’ouvrage contient dix-sept contributions dont une seule, le « Chalet basque », est inédite. Les autres textes ont suscité de vifs débats dans la communauté anthropologique et au-delà car ils forçaient tous à penser de manière critique les pratiques ordinaires des sciences de l’homme. Comme beaucoup d’autres, Jean Bazin avait commencé par être philosophe avant de faire du terrain en Afrique. Mais, à la différence de beaucoup de ses collègues, il l’était resté, comme le fait remarquer Vincent Descombes, co-préfacier de l’ouvrage. Il n’avait pourtant jamais renoncé au travail empirique, comme l’explique en toute connaissance de cause l’autre préfacier, Alban Bensa. Dans une série de textes denses mais toujours aisés à lire, Jean Bazin, nourri simultanément de la pensée de Marx et de celle de Wittgenstein, un alliage rare mais fécond ici, montre que la « culture » n’est pas un fait d’observation, ni une donnée d’expérience (ce que l’ethnographe rapporterait du terrain), mais c’est le produit d’une opération dont il convient de faire l’analyse critique. Contrairement au discours aujourd’hui dominant de la diversité culturelle, Bazin pense que le travail de l’anthropologie n’est pas de promouvoir l’altérité, mais de la réduire. C’est l’occasion pour lui de faire une très belle analyse de la notion d’authenticité et une déconstruction de la notion d’ethnie, dont le très beau texte « A chacun son bambara », témoigne magistralement. Il écrit ainsi : « Qu’on croit ou non à sa réalité substantielle, l’ethnie est ce sujet fictif que l’ethnologie contribue à faire être, le perpétuant comme entité de référence dans son espace savant, grâce à ses procédures inductives et attributives par lesquelles un contenu de savoir, si disparate soit-il, se trouve réuni et subsumé sous un seul nom, dans le même compartiment d’un fichier » (p. 107). Dans ses textes sur la description ou sur la production du sens dans l’opération ethnographique, il contribue d’une manière inédite à l’épistémologie des sciences sociales. À la différence de Dan Sperber, dans le Savoir des anthropologues, Jean Bazin ne renonce pas à l’anthropologie pour aller sur d’autres terrains : il recommande simplement une anthropologie armée par la philosophie et nourrie d’une réflexion politique, particulièrement sensible dans ses remarquables travaux d’anthropologie historique sur le royaume de Segou, où il montre l’existence d’un champ politique inchoatif, mais déjà présent. La reconnaissance d’une dimension proto-politique de la vie collective permet de ne pas tomber dans l’illusion des sociétés sans Etat comme sociétés libérées de l’instance politique. La critique serrée de l’œuvre de Pierre Clastres constitue l’un des moments forts du volume.
Pourquoi des clous dans la Joconde : une belle réflexion comparée sur le statut respectif d’un fétiche à clous africain présenté dans un musée et de la Joconde donne lieu à une analyse des rapports complexes de la chose et de l’objet, qui permet de comprendre beaucoup de choses sur le puissant mouvement d’esthétisation du primitif que l’anthropologie a ouvert et consolidé. Il est aujourd’hui possible de lire Jean Bazin aisément : remercions-en ses courageux éditeurs.
Jean-Louis Fabiani, EHESS
 Hervé Juvin est un manager éclairé qui réfléchit aux transformations du monde qu’il arpente dans ses voyages et ses lectures. Avec Produire le monde sous-titré Pour une croissance écologique et publié dans la collection de la revue Le Débat (Gallimard, 313 p., 20 €), il constate que les biens naturels comme l’air ou l’eau, sans lesquels la vie – sans parler du progrès - n’aurait pas été possible deviennent, de par leur raréfaction et leur coût, des enjeux financiers et industrielles considérables : en effet, une économie de la production de ces biens est déjà à l'œuvre, et elle porte en elle un dynamisme dont il faut avoir conscience, plutôt que de s’illusionner sur un possible retour à la nature. Ecrit dans un style inspiré, l’essai ne laisse pas indifférent même s’il tend à trop embrasser. L’auteur y développe une véritable philosophie du nouveau monde, haletante et passionnée.
Hervé Juvin est un manager éclairé qui réfléchit aux transformations du monde qu’il arpente dans ses voyages et ses lectures. Avec Produire le monde sous-titré Pour une croissance écologique et publié dans la collection de la revue Le Débat (Gallimard, 313 p., 20 €), il constate que les biens naturels comme l’air ou l’eau, sans lesquels la vie – sans parler du progrès - n’aurait pas été possible deviennent, de par leur raréfaction et leur coût, des enjeux financiers et industrielles considérables : en effet, une économie de la production de ces biens est déjà à l'œuvre, et elle porte en elle un dynamisme dont il faut avoir conscience, plutôt que de s’illusionner sur un possible retour à la nature. Ecrit dans un style inspiré, l’essai ne laisse pas indifférent même s’il tend à trop embrasser. L’auteur y développe une véritable philosophie du nouveau monde, haletante et passionnée.