
« Il n’y a pas d’un côté la littérature et de l’autre la vie, dans un face-à-face brutal et sans échanges qui rendrait incompréhensible la croyance aux livres […]. Il y a plutôt, à l’intérieur de la vie elle-même, des formes, des élans, des images et des manières d’être qui circulent entre les sujets et les œuvres, qui les exposent, les animent, les affectent. La lecture n’est pas une activité séparée, qui serait uniquement en concurrence avec la vie : c’est l’une de ces conduites par lesquelles, quotidiennement, nous donnons une forme, une saveur et même un style à notre existence. »
« Donner un style à son existence, qu’est-ce à dire ? Ce n’est pas le monopole des artistes, des esthètes ou des vies héroïques, mais le propre de l’humain : non parce qu’il faudrait recouvrir ses comportements d’un vernis d’élégance, mais parce que l’on engage en toute pratique les formes mêmes de la vie. L’expérience ordinaire et extraordinaire de la littérature prend ainsi place dans l’aventure des individus, où chacun peut se réapproprier son rapport à soi-même, à son langage, à ses possibles : car les styles littéraires se proposent dans la lecture comme de véritables formes de vie, engageant des conduites, des démarches, des puissances de façonnement et des valeurs existentielles. »
Voici un texte parfait, qui dit combien la lecture, exercice simple, proche, intime, offert à toutes et à tous, sans limites, sans entraves. Elle transforme nos vies, bouleverse nos existences, fait que nous devenons différents, plus profonds, que nous pensons plus loin, ailleurs, au-delà. Que nous sortons de nous-mêmes, que nous approchons de insoupçonnées. Que nous allons vers des mondes inconnus, que nous rencontrons des êtres d’exceptions. Que nous découvrons les vertus de l’écriture ainsi transmises.
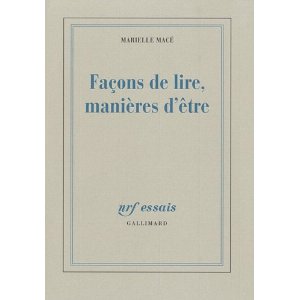
Mais cela, cette métamorphose à laquelle nous convie le livre, elle suppose de réfléchir au pouvoir de la lecture, à son déploiement dans les vies ordinaires. Marielle Macé, chargée de recherche au CNRS, auteure en 2006 d’une belle étude sur Le temps de l’essai (éditions Belin), nous y invite dans un remarquable essai, très original, courageux, merveilleusement écrit. Façons de lire, manières d’être (Gallimard, coll. « NRF essais », 288 p., 18,50 €). La lecture est dans la vie, il faut y penser sans cesse, et en cela, elle est la vie même, sauvée du temps qui l’entraîne dans l’oubli. Le livre et l’écriture dont il procède restituent le plus précieux, une invitation intime et universelle à sculpter sa vie, à révéler la « statue intérieure » de notre être plongé dans l’expérience, la mémoire et le temps. Au lecteur, « chaque forme littéraire ne lui est pas offerte comme une identification reposante, mais comme une idée qui l’agrippe, une puissance qui tire en lui des fils et des possibilités d’être. Il s’y trouve suspendu à des phrases, à ces forces d’attraction qui nourrissent en continu son propre effort de stylisation. »

Pas besoin d’être écrivain pour atteindre le temps retrouvé, il suffit de lire La recherche du temps perdu. Marcel Proust occupe, on s’en doute, une place importante dans la réflexion de Marielle Macé. « Si Marcel, le héros de Proust, se tourne en permanence vers des livres, s’il s’emploie lui aussi à les faire rayonner dans la vie, et s’il engage dans ses lectures tout son effort existentiel, ce n’est pas non plus parce qu’il serait d’une autre nature – ce n’est pas seulement pour devenir écrivain et s’y séparer des formes de l’existence commune. Non, pour eux comme pour nous, c’est dans la vie ordinaire que les œuvres d’art se tiennent, qu’elles déposent leurs traces et exercent durablement leur force. »
On remercie Marielle Macé pour ce livre, au seuil d’un été de lectures et de vie, d’avoir écrit ce livre limpide et lumineux, comme le soleil qui frappe la surface des flots et transforme l’eau en émeraude.
Vincent Duclert
Et, pour illustrer Façons de lire, manières d’être, on ne résiste pas au plaisir de convier Edouard Manet au festin, avec La liseuse (1879-1880), avec La lecture (1865-1873).
