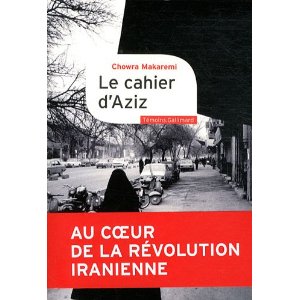
Alors que révolutions démocratiques et contre-révolutions sanglantes bouleversent le Moyen-Orient, il est important de se souvenir du destin de la révolution iranienne de 1979 – d’autant qu’elle a engendré un pouvoir tyrannique toujours à l’œuvre à Téhéran. Le cahier d’Aziz, publié aux éditions Gallimard dans la très importante collection « Témoins » (201 p., 16,90 €), nous rappelle cette historicité et cette proximité. Ce document venu des profondeurs de la société civile est édité par une jeune chercheuse de talent.
Née en 1980 à Chiraz en Iran, arrivée en France à l’âge de 6 ans, Chowra Makaremi est devenue anthropologue avec une thèse soutenue en avril 2010 à l’université de Montréal : Les zones d’attente pour personnes en instance. Une ethnologie de la détention frontalière en France. Revenue en France et actuellement post-doctorante au laboratoire IRIS, elle a traduit, édité et publié les carnets de son grand-père Aziz, écrits précisément pour elle et son frère, ses petits-enfants, afin qu’ils sachent ce que leur mère et leur tante ont enduré dans les prisons iraniennes de la République islamique et comment elles ont défendu, au milieu des tortures insondables et jusqu’à la mort, leur honneur, leur dignité, de combattantes de la liberté. Elles appartenaient en effet au mouvement des mojahedins du peuple qui avait été le fer de lance de la lutte contre la dictature du shah puis l’emblème de la révolution iranienne de 1979 avant d’être décapité par le pouvoir d’Etat islamiste dès 1981. Une répression à l’ampleur considérable s’en suivit. Elle dure toujours comme le montra en 2009 la violence extrême qui s’abattit sur les opposants au régime après les élections présidentielles contestées. Entre 1981 et 1988, le nombre de victimes de la dictature de Khomeyni serait de plusieurs dizaines de milliers. Douze mille noms de prisonniers exécutés entre 1981 et 1987 ont pu être recueillis, et cinq mille pour les exécutions en masse de l’été 1988. Des milliers de tombes ont disparu, les corps non retrouvés se comptent par milliers, les familles terrorisées se taisent. 300 000 personnes furent détenues et la plupart des vivants le sont encore.
La mère de Chowra est arrêtée le 15 juin 1981 à Chiraz, détenue pendant plus de sept ans dans des conditions effroyables qui transforment Fatemeh Zorei en morte vivante, sauvagement torturée à de très nombreuses reprises au point d'en perdre l’usage de ses jambes, enfin assassinée en 1988. Fataneh, sa sœur, la tante de l’auteure, est arrêtée quant à elle le 3 avril 1981 à Bandar-Abbas, et massacrée le 7 octobre 1982 après avoir subi trois simulacres d’exécution. Enceinte de huit mois à son arrestation, elle avait été torturée et exhibée dans la ville. Son crime et celui de Fatemeh ? Celui d’avoir été de jeunes femmes, éduquées, indépendantes, engagées politiquement dans le combat pour l’égalité, candidate à la députation aux élections législative de mars 1980, en passe d’être élues avant d’être privées de leur victoire par le Hezbollah chargé de briser le parti mojahedins. Soit une double transgression, celle de contester le pouvoir absolu du clan Khomeyni (après celui du shah), et celle de l’avoir fait en tant que femme.
Leur père, Aziz Zarei, consacra tout son temps et ses maigres revenus à tenter d’avoir de leurs nouvelles, à aller de prison en prison pour espérer les voir quelques instants et découvrir leur état de terreur et d’écrasement, leur être de « statue figée » selon les mots confiés par Fatemeh. Malgré cela, elles refusèrent de plier. Elles moururent dans la conviction qu’elles étaient demeurées fidèles à une éthique de la vérité, répondant au juge religieux Ramezani qui exigeait de Fatemeh qu'elle lise une déclaration de repentir : « Lire cette lettre à la télévision signifiait non seulement piétiner mon honneur et ma personne, mais aussi entacher ceux des autres, ce qui m’aurait attiré une malédiction éternelle. Pour vivre quatre jours de plus en ce monde, aurais-je dû répondre du sang versé des meilleurs jeunes gens de cette terre au jour du jugement dernier ? »
Le cahier d’Aziz débuta le 22 décembre 1988 au dos de l’exemplaire du Coran que le vieil homme conservait toujours avec lui. Puis il poursuivit sa narration dans un grand cahier dont il noircira la moitié des pages jusqu'à sa mort en 1994, décédé dans l’avion qui le ramenait en Iran après un bref séjour chez sa famille réfugiée en France. Les premiers mots disent sa volonté de fixer la réalité de la vie et du martyre de ses filles alors que la violence d’Etat, si implacable, pouvait aboutir à arracher à ces « ennemis » leur réalité même, leur réalité sociale de femmes cultivées et engagées, et jusqu’aux souvenirs que leurs proches espéraient pouvoir conserver, en exerçant sur ces derniers une terreur permanente. Comment une famille croyante, simple, réduite aux générations des grands-parents et de petits-enfants fait-elle pour survivre et tenter, jour après jour, d’avoir des nouvelles de ses filles, d'essayer de les entrevoir en prison, d’attendre des heures une hypothétique autorisation de visite. Ces pratiques terroristes des années 1980 en Iran se sont répétées dans les années 1990 puis 2000, elles continuent, ce sont les mêmes que l’on retrouve, comme en Syrie, sous d’autres régimes saisis par la même violence administrée aux corps et aux âmes.
Le cahier d’Aziz, qui témoigne de ces systèmes de terreur autant que de la résistance jusqu’à la mort de victimes refusant leur sort, a été retrouvé en 2004 par Chowra Makaremi, à leur domicile de France alors que son grand-père était reparti sans retour en Iran. Elle demande à sa tante, une autre des filles d’Aziz heureusement réfugiée en France quand ses sœurs étaient martyrisées, de le lui lire et d’enregistrer cette lecture. Chowra mettra six ans pour en accepter la vérité et se décider à l’éditer et le publier. Elle le fera lorsqu’elle comprendra, jeune chercheuse à Montréal, la nécessité de donner une vie publique à ce témoignage individuel, intime. Cette certitude est venue de l’épreuve du travail de traduction. Dans une longue postface, « La traversée », Chowra explique : « C’est dans l’intensité étrange et brute de cette parole arrachée à la mort que la certitude a pris forme : le cahier d’Aziz devait être publié. Il témoignait, à travers le récit d’un homme qui confessait "prendre la plume en l’une des rares occasions de sa vie", de ces moments où l’histoire pénètre les vies individuelles et en façonne aussi bien le cours que la texture même. Ces moments où les destins singuliers, les expériences subjectives du temps et les événements du siècle se fondent dans un même creuset brûlant, aux bords duquel se retourne, les yeux écarquillés, un père au soir de sa vie. »
L’édition de ce document rend un très bel hommage à la puissance politique des écritures ordinaires à condition seulement qu’elles soient révélées et publiées. Elle donne vie à des existences niées, enfouies dans les ténèbres des prisons d’Etat. La première vie aussi en Iran de la petite-fille qu’a été Chowra Makaremi, dans l’absence de sa mère, aux côtés de son grand-père. « Dans les matins froids de Chiraz, il prenait ma main dans la sienne, la serrait fort et me faisait traverser la rue pour m’emmener à l’école maternelle. »
La petite-fille de Chiraz, grandissant en pensée avec sa mère encore vivante, a réalisé, avec la publication du Cahier d’Aziz, un acte de recherche autant qu’elle s’est souvenu d’une dette. Editer un document comme celui-ci relève du travail régulier de l’anthropologue. En pemettre la lecture donne une nouvelle existence à sa mère et à sa tante. Les lecteurs présents et à venir de ce livre (et nous espérons que notre article en décidera plus d’un) découvriront aussi comment ces destins individuels de femmes iraniennes libres informent la longue durée de la République islamique, comment « les responsables et exécutants des massacres de 1988 sont au pouvoir aujourd’hui », comment les mêmes méthodes de terreur et de déshumanisation se perpétuent, comment le silence s’est fait sur cette guerre de trente ans contre les « ennemis intérieurs ». L’actuel président de la République Mahmoud Ahmadinejad, dont la réélection contestée a ouvert un nouveau volet de terreur et de répression en Iran en 2009, était instructeur dans le « Corps des Gardiens de la révolution islamique » (Pasdarans), « en charge des mises à mort et des tortures », indique Chowra Makaremi dans sa préface. Quant à Geoffrey Robertson, un juriste international qui présida le tribunal spécial de l’ONU pour le Sierra Leone et qui mena une enquête sur les massacres des prisons iraniennes en 1988, il souligne que « la situation en Iran aujourd’hui illustre les conséquences de l’impunité de crimes contre l’humanité qui n’ont jamais donné lieu à des investigations sérieuses et n’ont pas été reconnus. »
Du moins le travail de Chowra Makaremi et le choix d’un éditeur – que nous saluons - de le rendre public déchirent-ils le voile d’oubli et de silence dont se nourrit l’impunité des bourreaux. Ils disent aussi, l’un comme l’autre, que les traces écrites des personnes, qu’elles prennent la forme d’un cahier manuscrit en persan ou un livre broché en français, opposent à la tyrannie la force de la connaissance : « comment des milliers d’hommes et de femmes, prisonniers politiques, furent exécutés et ce qu’ils vécurent. Comme l’écrit mon grand-père par une dénégation dont je comprends et épouse la tension : "Que cela ne reste pas non dit." »
Vincent Duclert
